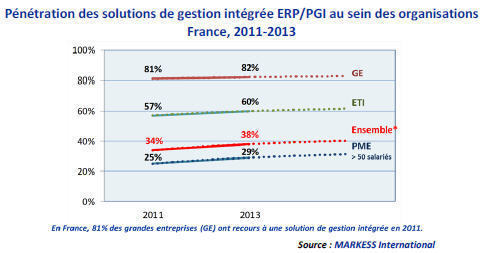La note présente est un bilan, un peu sombre. Elle comporte quelques propositions de principe, mais pas de recettes précises. Il nous semble qu’à moins de transformations sérieuses de la situation économique générale et, plus profondément, du climat social et moral, les améliorations qu’on pourrait apporter à l’enseignement supérieur resteraient lettre morte puisque
ce n’est pas à l’université de pourvoir à l’emploi des étudiants mais à la société ; et quand bien même l’éducation aurait fait tout ce qui dépend d’elle pour leur
employabilité, cela ne leur assurerait pas
l’emploi : ce n’est donc pas seulement parce que l’enseignement en général et l’enseignement supérieur en particulier prépareraient mal à entrer dans le monde du travail, que les diplômés peinent à entrer dans la vie professionnelle. On retrouve ici clairement que si c’est à l’école de s’adapter à la société
telle qu’elle est, il n’y a aucune solution aux problèmes de l’éducation (et de l’école dans son entier), ce qui nous ramène à Bachelard et à l’idée que c’est à la société d’être pour l’école et pas l’inverse.
C’est donc cette mise en concurrence systématique et généralisée des « ressources humaines » tant par le management des entreprises que par le fonctionnement général de l’économie néolibérale qui est la raison profonde du déclin et même du délabrement de notre enseignement supérieur. En dehors des voies d’excellence traditionnelles, du reste de plus en plus socialement sélectives, l’enseignement supérieur long est frappé de stérilité ; l’enseignement supérieur court semble en ce moment mieux conduire à l’emploi, mais parce que cela permet aux entreprises de recruter des personnels moins payés, tandis que les autres poursuivent de plus en plus souvent leurs études pour ne pas rester sans rien faire ; tout un secteur de l’université est une zone d’attente peuplé de jeunes laissés à la charge de leurs famille en attendant des jours meilleurs. Cette situation forme de plus un système de nature à tirer l’ensemble des coûts salariaux vers le bas. Ensuite, on met en cause le défaut dit de professionnalisation de l’université, alors que dans le même temps les efforts qui peuvent être faits pour rendre plus professionnalisantes les formations contribue au moins pour une part à accroître la précarité des emplois. La spirale du déclin fait qu’en effet la qualification des étudiants longs diminue (je ne confond pas qualification et professionnalisation), si bien que les entreprises les plus grosses créent leur propre centre ou système interne de formation, et après cela on redoute ici, et là on souhaite la disparition pure et simple de l’enseignement supérieur public, en oubliant que souvent, en matière de qualification, les institutions privées ne font pas mieux (on n’apprend pas grand chose dans une école supérieure de commerce ; on y est simplement sélectionné par l’argent : c’est l’origine sociale qui détermine la réussite, sa rapidité, sa facilité).
Face à cette situation, 2 positions : l’une consiste à conclure que l’université (ou du moins des pans entiers de celle-ci) étant devenue stérile, est une dépense inutile et doit soit céder la place à des filières privées, soit pour redevenir défendable être moins accessible et plus onéreuse (c’est l’évolution en cours) ; l’autre n’abdiquerait pas et tiendrait pour essentiel de défendre une conception« républicaine » (et non libérale) de l’université, conçue comme service public, laquelle n’est incompatible ni avec l’autonomisation des universités, ni avec l’existence d’un enseignement supérieur privé, pourvu que des règles saines et claires de fonctionnement commun assure une cohérence et une justice suffisante de l’ensemble, ce qui n’est à l’évidence plus le cas. Ici comme ailleurs la dépendance à l’égard de l’argent et le développement des pratiques locales discrétionnaires doivent être corrigés.
- Jungle et ruines
- Public/privé
- Culture et spécialisation
- Le scandale des stages
A . Jungle et ruines
En dehors des classes préparatoires et des grandes écoles qui tiennent encore leur rang, l’enseignement supérieur dans sa globalité (public + privé) est devenu une jungle, où les étudiants ont de plus en plus de mal à s’orienter, un labyrinthe agrémenté de ruines plus ou moins avancées, càd d’institutions dont la fréquentation ne mène nulle part et qui sont devenues des zones d’attente incapables d’offrir aux étudiants le moindre débouché. Encore faut-il noter que les classes préparatoires ne se valent pas toutes ; si la qualité de l’enseignement y reste en moyenne de très bonne qualité, le recrutement ne peut plus éviter de laisser y pénétrer de plus en plus souvent des élèves qui ne sont pas au niveau d’exigence requis par la perspective des concours : c’est une conséquence fatale de la dégradation de l’enseignement primaire et secondaire, qui par un effet de boule de neige fait que la qualification des enseignants ayant reculé, celle des enseignés en est affectée. Simplement les élèves sélectionnés pour y entrer étant en principe les meilleurs, sont capables d’y faire des progrès rapides et en 2 ou 3 ans de se hisser à un niveau honorable : actuellement leur niveau de sortie est à peu près ce qu’aurait du être, en moyenne, leur niveau d’entrée. Ce qui veut dire que, moyennant une stratégie adaptée, il doit être possible de remédier assez rapidement au délabrement de notre école – et confirme bien que le problème crucial à résoudre est celui de la qualification des maîtres. On peut aussi noter que sont apparues dans ce secteur des entreprises de soutien semblables à celles qui tirent profit de l’inefficacité de l’enseignement secondaire, ce qui veut dire que le « marché » qui les intéresse s’est étendu.
La jungle : les étudiants sortant des lycées sont lâchés dans un territoire où ils doivent apprendre seuls et souvent à leurs dépens à s’orienter, et où ils se heurtent aux effets pervers d’une coexistence mal ordonnée d’institutions publiques et privées. D’une part le déclin de pans entiers de l’enseignement supérieur au moins dans le 1
ercycle du système (Licence), incite souvent les familles et les étudiants à se tourner vers des institutions privées onéreuses, et dont l’enseignement ne vaut pas toujours ce qu’il coûte. Ainsi naguère, lors des blocages des universités, spécialement des facultés des lettres, on a vu les écoles supérieures de commerce lancer des campagnes de recrutement (par voie d’affiche, via internet, ou même par des commandos lancés dans la cour des miracles des facultés). Il eut été étonnant que des professionnels du marketing ne songent pas à profiter de l’opportunité qui s’offrait alors. D’autre part, l’autonomisation des universités a cet effet paradoxal que, malgré l’hostilité persistante des enseignants du public envers le privé, les universités en viennent à se comporter de la même manière que les institutions privées : elles décident de manière discrétionnaire des recrutements, équivalences et passerelles : par exemple le passage de L en M est en principe soumis à des règles d’équivalences qui autorisent le passage des étudiants du public vers le privé et inversement, mais dans les faits ces mouvements sont souvent difficiles à négocier et soumettent les étudiants à des difficultés souvent d’autant plus grandes qu’elles sont pour eux en partie imprévues.
L’autonomisation des universités, à supposer qu’elle soit opportune et en elle-même un bien, n’a pas résolu son problème principal : la médiocrité des enseignements qui y sont donnés et l’échec monstrueux des étudiants dans le 1
er cycle (le L du LMD). D’une part les étudiants sont forcément médiocres puisqu’ils sont recrutés dans le tout venant des lycéens ; d’autre part ils ne sont pas motivés puisqu’ils sont conduits à la fac par défaut ; enfin les professeurs du second cycle (les plus jeunes très souvent, à qui on confie les corvées) sont découragés d’avoir à enseigner des troupeaux d’étudiants mal préparés et peu réceptifs, d’autant que pèsent aussi sur eux comme chercheurs des contraintes assez lourdes : enseigner est donc pour eux une punition (ils préparent mal ou peu leurs cours, ne donnent pas de devoirs…). Enfin,
last but not least, le climat d’ensemble créé par ces relations fait que même les professeurs titrés et compétents délaissent parfois leurs cours et ne les assurent que dans l’ennui et le radotage.
Les ruines : il fallait s’attendre à ce que les professeurs d’université ne tombant pas du ciel, mais se recrutant parmi des générations de « mal-appris », leur niveau soit fort disparate et souvent bien insuffisant. En dehors de quelques bastions privilégiés, dans beaucoup de secteurs des facultés de province (mais pas seulement) sont mis face à face des étudiants et des enseignants médiocres. On aurait tort de penser que ce nivellement rapproche les enseignés et les enseignants et les adapte les uns aux autres ; ici, comme au collège ou même à l’école élémentaire, ce double déclin ne facilite pas la communication mais la compromet gravement, parfois définitivement. C’est donc bien là aussi la formation des maîtres et la redéfinition de leurs obligations qui est au cœur de la question. ...
28 Septembre 2011
Par
philalethe
Lire la suite
http://blogs.mediapart.fr/blog/philalethe/280911/sur-lenseignement-superieur